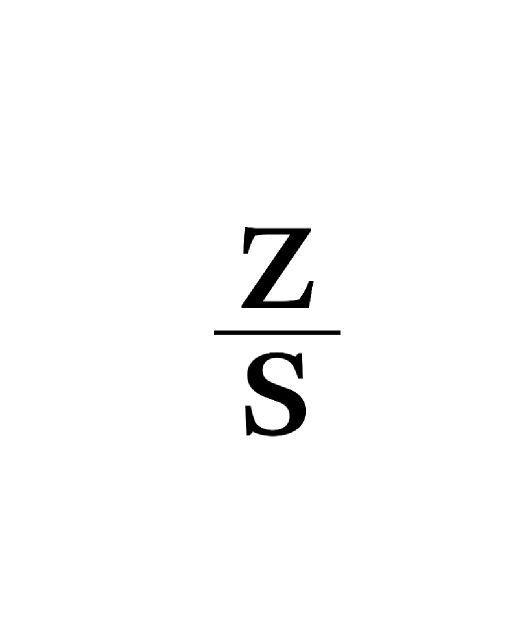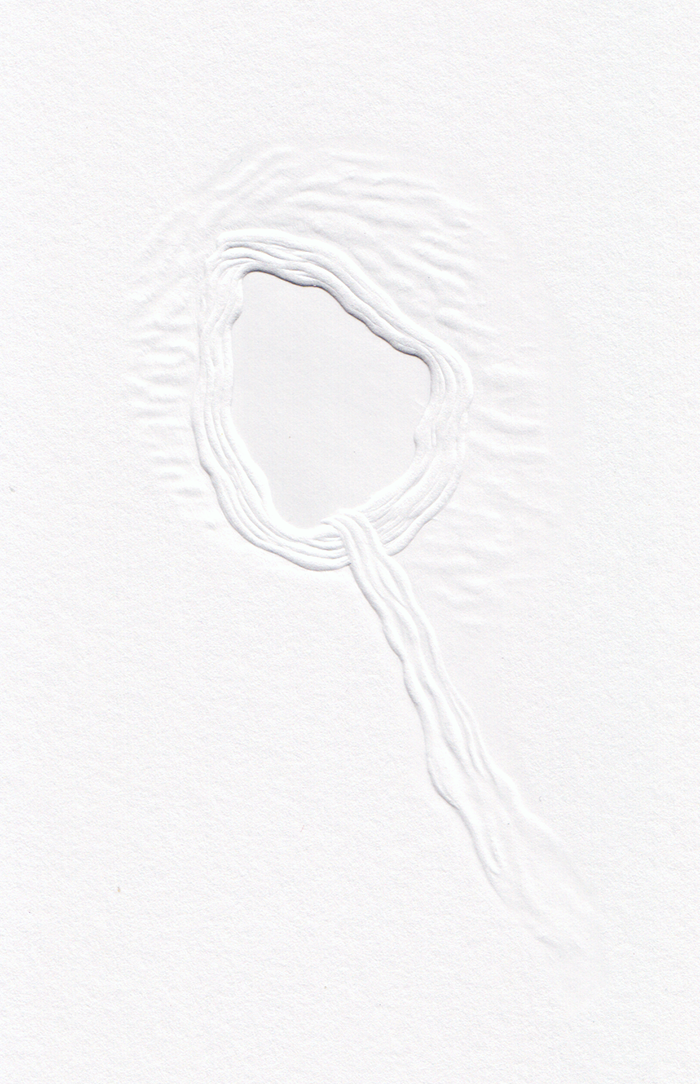KEITH BASSO
L’EAU SE MÊLE À LA BOUE DANS UN BASSIN À CIEL OUVERT
PAYSAGE ET LANGAGE CHEZ LES APACHES OCCIDENTAUX
196 p. ISBN 978 293 0601 21 2. 20 euros.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-François Caro.
Préface de Carlo Severi. 8 illustrations.
Sortie le 22 avril 2016.
[Suite à une erreur dans la production graphique de cet ouvrage, l’intérieur du livre comporte malheureusement un certain nombre de co(q)uilles. Zones sensibles tient à s’excuser auprès de ses lecteurs pour ces fautes inexcusables.]
« Fabrications humaines par excellence, les lieux sont ce que l’on en fait – ils sont tout ce qu’on les tient pour être –, et leurs voix désincarnées, immanentes bien qu’inaudibles, ne sont que celles de ceux qui se parlent à eux-mêmes en silence. Que font les peuples avec les lieux qu’ils habitent ? Cette question est aussi lointaine que les peuples et les lieux eux-mêmes, aussi lointaine que l’attachement des êtres humains envers certains endroits de la planète. Aussi lointaine, peut-être, que la notion de foyer (“notre terre” par opposition à “la leur”), aussi lointaine qu’un profond sentiment d’appartenance géographique », écrit Keih Basso dans l’introduction de L’eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert, son premier ouvrage traduit en français. « Dans l’époque turbulente qui est la nôtre, marquée par le déracinement des populations et l’ampleur des diasporas, il devient de plus en plus difficile de se raccrocher à des lieux (et de prendre pleinement conscience de ce qu’ils ont à nous offrir), et je crains que cela soit considéré partout comme un privilège et un don dans les années à venir. Les Indiens d’Amérique, qui furent les premiers à peupler ce continent et les premiers à en être chassés, ne le comprennent déjà que trop bien. Puissions-nous apprendre de leur expérience », ajoute-t-il. En s’inspirant, comme Tim Ingold (dans Marcher avec les dragons) mais avec une toute autre approche, d’écrits comme ceux de Martin Heidegger (« Bâtir habiter penser ») et de Jean-Paul Sartre, Nelson Goodman, Cormac McCarthy ou encore Niels Bohr, Keith Basso offre dans cet ouvrage de magnifiques réflexions sur les liens entre l’environnement, l’incarnation des lieux et le langage.
SOMMAIRE
Préface (Carlo Severi)
Guide de prononciation de l’apache occidental
Introduction
1. Citer les ancêtres
2. Les conteurs sont des chasseurs
3. Parler avec les noms
4. La sagesse des lieux
Épilogue
Bibliographie
Table des illustrations
Keith Basso (1940-2013) était anthropologue et rancher, professeur émérite à l’université du Nouveau-Mexique. L’eau qui se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert est son premier ouvrage traduit en français. Carlo Severi, anthropologue, est membre du Laboratoire d’anthropologie sociale (Collège de France, Paris).
EXTRAIT DE LA PRÉFACE
Dieu réside dans le détail. Ce dicton, souvent associé à l’œuvre d’Aby Warburg, s’applique parfaitement à celle de Keith Basso (1940-2013). Linguiste rigoureux, homme solitaire et très discret, Basso est avant tout un observateur attentif de phénomènes qui peuvent sembler, à première vue, mineurs ou négligeables. Une fois choisie la population à laquelle il consacre son travail et sa vie, qui sera toujours celle des Apaches occidentaux en Arizona, Basso choisit régulièrement de menus détails de la vie courante, pour en faire, sans raison apparente, ses sujets d’analyse préférés. Un de ses articles les plus remarquables, par exemple, est consacré au rôle du silence dans la conversation quotidienne des Apaches (Basso, 1970). Dans d’autres textes (Basso, 1979), il discute longuement la notion de portrait verbal du Blanc (railleur, ironique, grinçant), tel qu’il est pratiqué par les Apaches qui en ont fait un véritable « genre littéraire verbal ». Ces exercices de littérature orale s’expriment souvent dans des lieux peu fréquentés par les anthropologues : des diners, des bars, des stations d’essence, des casernes ou des supermarchés situés dans la réserve de White Mountain. Basso, toutefois, n’écrit jamais des vignettes, terme américain qui désigne des saynètes, ou des épisodes typiques, qui servent à alimenter les stéréotypes. L’attention qu’il consacre à certains détails de la vie sociale des Apaches n’a rien d’épisodique. Au cours de son expérience d’ethnographe dans la réserve de White Mountain, si longue qu’elle coïncide presque entièrement avec sa vie de chercheur, Basso a pu s’occuper de religion, de rituel ou d’histoire. Mais même lorsqu’il se consacre à ces sujets, plus courants en anthropologie, son regard reste décalé. En se penchant sur l’histoire des Indiens, il ne travaille pas seulement sur des récits d’histoire orale ; il choisit de faire la chronique et l’analyse des mouvements messianiques, ces « nouvelles religions » amérindiennes où présent, passé et futur se condensent en un seul temps paradoxal, où cohabitent les visions, les rêves, et les préfigurations utopiques, voire apocalyptiques. Prenons un exemple.
En 1906, un jeune Apache occidental, nommé Silas John, a une vision. Comme d’autres jeunes Apaches, John a longuement cherché à susciter en soi cette expérience. Il a suivi le parcours de tout jeune guerrier apache qui aspire à la fonction chamanique. Il s’agit d’un itinéraire traditionnel qui prévoit le jeûne, l’absorption de drogues, de longues périodes de vie solitaire dans les forêts. John a également suivi, naturellement, l’enseignement d’un chamane expérimenté, en l’occurrence son père, qui connaissait en particulier les chants consacrés aux serpents. Comme le prévoit la tradition, l’apprentissage d’un savoir chamanique le conduit un jour à une expérience « directe » du monde surnaturel. Il « voit » un esprit-serpent, qui devient son gan – son double surnaturel. C’était, bien sûr, ce qu’il lui fallait pour devenir, un jour, chamane à son tour.
Mais la vision de John a aussi un aspect exceptionnel. Elle acquiert immédiatement, dans les villages apaches, une notoriété singulière. Revenu de son expérience, John raconte en effet que l’esprit surnaturel avec lequel il a pu entrer en contact ne lui a pas seulement communiqué, comme à d’autres jeunes aspirants à la fonction chamanique, la connaissance de quelques chants rituels destinés à la guérison d’un certain nombre de maladies ; il lui a aussi révélé un « alphabet » qui lui permet de transcrire ces chants et de les fixer dans sa mémoire. L’apprentissage chamanique de Silas John va engendrer un des mouvements messianiques les plus intenses et les plus violents que les Indiens d’Amérique du Nord aient connu. De tout cela, on l’imagine bien, il restait, dans les année 1970, lorsque Basso commence son enquête, peu de traces : la déclaration d’un officier de la garnison de la réserve, qui « interdisait aux Indiens d’inventer de nouvelles religions » (Severi, 2007) ; les souvenirs de quelques fidèles du culte de Silas John (MacDonald Boyer et Gayton, 1992) qui se rappelaient encore, par exemple, du moment où Silas leur demanda de l’appeler « Jésus » ; quelques planches de dessins énigmatiques restaient encore dans les maisons de certains fidèles, où Silas avait « écrit », par pictographie, ses nouvelles prières. De ces bribes, il était bien difficile de tirer une description exacte du culte rebelle fondé par Silas. Mais Basso reprend le dossier, reconstruit la biographie du jeune Apache, qui avait bien connu l’enseignement des missionnaires protestants néerlandais ; retrouve les chroniques des premiers moments de l’insurrection guidée par Silas John, et surtout, il décrit soigneusement, en linguiste chevronné, les aspects sémiotiques de la pictographie « vue en rêve » par le jeune chamane. Basso prend donc tout à fait au sérieux cet « alphabet » surnaturel, qui découle d’une expérience onirique. Le rêve de Silas John, dont le souvenir était pratiquement perdu, perdure aujourd’hui dans un article (Anderson et Basso, 1975) qui a toute l’apparence d’une étude technique, réservée aux spécialistes, mais qui a aussi la force de faire renaître l’utopie de Silas John.
Dans L’eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert (publié en anglais en 1996 sous le titre Wisdom Sits in Places), c’est la notion de lieu qui est l’objet de l’analyse de Keith Basso. Il s’agit cette fois de répondre à une commande du Conseil tribal de White Mountain. On lui demande de « faire une carte » du territoire de la réserve – mais pas une carte comme celles que font les Blancs ; ces cartes-là , lui explique Ronnie Lupe, le président de la communauté, on les a déjà. Des cartes apaches, avec des noms apaches. Basso monte un projet. Il prélève ce qu’il faut du savoir traditionnel, et tait ce qu’on lui demande de taire. Le résultat, toutefois, n’est pas une carte de la réserve, qui ne sera jamais publiée, mais une série de « prises de vue » (Basso les appelle des takes, en empruntant le terme à la photographie) sur la culture traditionnelles des Apaches. Le lecteur s’aperçoit vite que la force de Basso, son style d’analyse, réside précisément dans sa capacité de faire surgir, à partir de la description minutieuse d’un cas, ou de quelques détails, des idées nouvelles, et même des perspectives théoriques tout à fait inattendues. Considérons, par exemple, la notion d’espace, qui joue naturellement ici un rôle crucial. En anthropologie, l’espace est un concept rarement considéré en tant que tel. Clifford Geertz (1996) écrit par exemple que dans l’index d’un manuel d’anthropologie on trouvera rarement une entrée « Espace ». Bref, pour les anthropologues, l’espace n’a rien de spécifique – « cela va sans dire » (Geertz, 1996, p. 259). Ce qui compte pour l’ethnologue, c’est l’expérience sociale qui se réalise dans un lieu, non le lieu lui-même. Or, que fait Basso pour esquisser sa propre anthropologie de l’espace ? Reprenons le titre et l’exergue qu’il a utilisés lorsqu’il a republié le quatrième chapitre du présent ouvrage, « La sagesse des lieux », en tant qu’article dans un recueil édité avec Steven Feld (Baso & Feld, 1996). Basso annonce sa stratégie de recherche par le choix du titre, du sous-titre et de l’exergue. Le titre se passe de commentaire : il s’agit de restituer un savoir indigène et son espace. Le sous-titre (« Notes on an Apache Landscape ») est, lui, on ne peut plus modeste : ce chapitre ne parle pas d’un ensemble de remarques, ni d’une conception de l’espace ; il « réunit quelques notes à propos d’un paysage apache ». L’exergue, brusquement, élargit démesurément l’horizon. Le voici : « Le lieu est le premier de tous les êtres, puisque tout ce qui existe, existe dans un lieu et ne peut exister sans un lieu (Archytas, Commentaire sur les Catégories d’Aristote). » Ici, Basso change de jeu. Non seulement il se réfère à un auteur relativement obscur, Archytas, que seuls les spécialistes de la philosophie grecque connaissent. Mais le texte déclare bien que rien n’est plus général que le concept d’espace, puisque rien ne peut exister sans lui. Il s’agit donc de résoudre précisément le problème posé par Geertz. Pour ce dernier, comme on vient de le voir, on ne peut imaginer une anthropologie de l’espace puisque ce concept est soit trop spécifique (trop lié à des expériences ponctuelles), soit si général qu’il ne peut permettre aucune généralisation significative. « Separated from its materializations », écrivait Geertz, « space has little meaning » (Geertz, 1996, p. 259).
À PROPOS DU LIVRE
Keith Basso au Musée du Quai Branly
Le 20 octobre 2016 a eu lieu une rencontre au Musée du Quai Branly, dans le cadre des Rendez-vous du salon de lecture Jacques Kerchache, autour de L’eau se mêle à la boue… avec Valentina Vapnarsky, ethnologue, et Carlo Severi, anthropologue et préfacier de l’ouvrage. Pour réécouter cette rencontre, c’est ici.